accueil > Littérature > article
Artistes
- [ Amin Maalouf ]
Samarcande, d’Amin Maalouf
Trompeuses senteurs d’Orient.
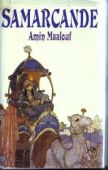 Omar Khayam est mathématicien de renom, disciple d’Avicenne, et surtout poète et philosophe. Et ce n’est pas toujours bon de l’être lorsque les temps sont troublés, en quelque religion que ce soit. Samarcande, c’est la merveille de la Perse, le point de départ de l’histoire du manuscrit de cet esprit éclairé des temps passés.
Omar Khayam est mathématicien de renom, disciple d’Avicenne, et surtout poète et philosophe. Et ce n’est pas toujours bon de l’être lorsque les temps sont troublés, en quelque religion que ce soit. Samarcande, c’est la merveille de la Perse, le point de départ de l’histoire du manuscrit de cet esprit éclairé des temps passés.
Omar Khayam serait né en 1047 à Nichapour, dans l’immense empire Perse. Esprit séduit par la découverte de nouvelles sciences, il construit un observatoire à Merv et réforme le calendrier perse. On lui attribue une quinzaine d’ouvrages scientifiques, dont un seul - traitant des équations au second et au troisième degré qu’il parvenait à résoudre - est parvenu jusqu’à nous.
Ce sont les talents de poète de Khayam qui intéressent Amin Maalouf. Il place au coeur de son roman un manuscrit du perse, composé de Robaïyat : Ce sont de courts poèmes de quatre vers : les deux premiers et le quatrième riment entre eux, le troisième, lui est blanc. Leur brièveté implique que l’auteur cingle le coeur de son propos pour énoncer son idée sans fioriture. La traduction par Edward Fitzgerald des Rubayat de Khayam remet ceux-ci à l’honneur en 1859, en pleine mode d’Orient. Maalouf se saisit de ce regain d’intérêt pour étirer son réçit du XIe siècle jusqu’aux révolutions d’Iran au XIXe, dans lesquelles le narrateur se trouvera finalement pris.
Cependant, il semble que nombre des poèmes de ce manuscrit, qui sont attribués à Khayam, soient en fait des pastiches ou des hommages. Ils sont venus se greffer aux originaux au cours des siècles, et aujourd’hui, aucune analyse ne parvient à faire autorité sur ce sujet. Maalouf, lui, opte pour une version romancée de la vie du poète de Nichapour. Il en fait un personnage pris entre diverses figures historiques dont Hassan ben Sabbah, fondateur de la secte des Assassins [1], le grand Nizam-el-Molk La légende veut en effet que Hassan Sabbah, Nizam-el-Molk et Khayam aient été proches, cependant il n’existe aucune certitude à ce sujet.
Pour organiser cette fresque, entre poésie, figure quasi-mythique de Khayyam, et contexte historique, Amin Maalouf choisit de suivre les périgrinations du manuscrit de Khayam : Depuis le début de son écriture à Samarcande, entre les les bras parfumés de Djahane et la saveur du vin, jusqu’à ce qu’il quitte la Perse pour sombrer avec le Titanic, cette idée s’avère un fil conducteur efficace.
Mais il est trop lacunaire, et le roman se divise en deux histoires trop distanciées. Sur près de ses deux-tiers, la narration s’attarde sur la figure - certes enthousiasmante - de Khayam, esprit tolérant, épicurien et génie de son siècle, qui s’oppose à la violence du fanatisme religieux ou à l’ambition dévorante des politiques madrés. Puis, après un bref passage au XIVe siècle, on s’attarde sur une amourette improbable entre le narrateur, orientaliste pris dans la révolution, et une princesse de Perse. À dire vrai, toute la magie du roman s’évanouit durant cette seconde partie, dont les ressorts et rebondissements ont bien du mal à échapper à la figure de Khayam qui écrase décidément ce Samarcande.
Cette disparité entre les deux moments du roman est sans doute accentuée par le style d’Amin Maalouf, parfois un peu fleuri, qui s’accomode bien des épisodes auprès de Djahane, ou de la belle ville de Samarcande. Mais ce lyrisme reste superficiel, et peine à donner du souffle à l’oeuvre dès lors qu’elle se confronte au passage des siècles. Samarcande n’est agréable à lire que dépourvu de son superflux, ce qui contraint son auteur à multiplier les scènes vues de loin, et à condenser les temps longs de son histoire en peu de mots. Dès qu’il doit diffracter le temps dans sa narration, Amin Maalouf devient plus maladroit, et il ne parvient plus à convaincre.
Alors que la Perse splendide, Khayam, les assassins, Djahanne offraient matière à un roman châtoyant, on ne peut s’empêcher d’être déçu du peu d’odeurs, de couleurs et de textures de ce Samarcande.
On complètera la rencontre avec Omar Khayam par cette lecture sur le site des éditions José Corti et cette succinte biographie.
par Pierre Raphaël
Article mis en ligne le 6 décembre 2004 (réédition)
Publication originale 24 février 2002
[1] Ou Hachîchim, terme qui viendrait de l’arabe hachîchi, qui désigne celui qui consomme du chanvre indien, ou hachîch (herbe en arabe). Il existe toutefois une controverse sur l’origine du terme Assassin, laquelle est expliquée sur ce site




