Artistes
Tharaud façonne un Grand Œuvre pianistique
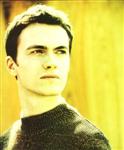 La musique - en quelques rares occasions - a un pouvoir alchimique. Le récital donné par Alexandre Tharaud à Marcilhac-sur-Célé a transformé une matière pianistique inerte en un voyage surréaliste. Etait-il possible de ressortir de ce concert autrement qu’essoufflé, tendu par les instants vécus ? La période du concert n’apparaît plus comme une collection d’instants saccadés, mais comme une œuvre à part entière, une œuvre composée d’interprétations et de silences.
La musique - en quelques rares occasions - a un pouvoir alchimique. Le récital donné par Alexandre Tharaud à Marcilhac-sur-Célé a transformé une matière pianistique inerte en un voyage surréaliste. Etait-il possible de ressortir de ce concert autrement qu’essoufflé, tendu par les instants vécus ? La période du concert n’apparaît plus comme une collection d’instants saccadés, mais comme une œuvre à part entière, une œuvre composée d’interprétations et de silences.
L’atmosphère de la "salle" était en soi assez curieuse. On est dans le Lot, loin des salles parisiennes : les seuls lieux ouverts à la musique sont les églises, ou comme dans ce cas, les abbayes. L’ambiance est décontractée, le prix du billet raisonnable. Rapidement le piano au centre de la nef est l’objet de l’attention du public. On vient toucher les cordes, caresser les courbes. L’accordeur est assailli de questions alors qu’il tente de faire son travail. D’autres sont assis sagement, pas mal discutent, les gamins courent autour des bancs. Ce fourmillement de personnes aurait pu être le sujet d’une scène de Sempé : chacun vaque à ses occupations mais en participant inconsciemment à une scène réglée au millimètre.

Tout ça rentre peu à peu dans l’ordre, puis Alexandre Tharaud apparaît. La technique de Tharaud, illustrée dès les premières mesures d’une série de quatre concertos de Bach, est contondante - physique : il malaxe avec rigueur et dextérité les harmonies, enveloppe la ligne mélodique d’une clarté sonore époustouflante. Chaque note est travaillée non seulement dans son attaque mais aussi dans sa tenue et sa disparition. Le tissu musical qu’il tend est à la fois dense et clair : les échos et réverbérations sont maintenues dans le cadre rigoureux de l’harmonie. Il n’est jamais débordé par les notes et plusieurs dizaines de sons peuvent s’organiser, se combiner, se transformer, se réduire ou se développer le long d’une ligne mélodique qu’il tire au cordeau.
Suivent après l’entracte une œuvre de Delvincourt [1], un auteur méconnu du XXème siècle. Ce n’est pas un artiste de la trempe de Ravel (qui nous est promis pour la fin du spectacle !), mais il ne mérite sans doute pas l’oubli dans lequel il est tombé. Tharaud adopte sans sourciller un style plus dépouillé, moins finement ciselé que la mécanique de Bach mais qui correspond parfaitement à l’esprit de ces Heures juvéniles : légèreté et virtuosité.
 Puis, finalement, Tharaud attaque enfin Gaspard de la Nuit, le poème pianistique que Ravel a construit autour d’une œuvre d’Aloysius Bertrand [2]. Comme pour Bach la technique est parfaite, le pianiste est parcouru de secousses électriques, même dans les pianissimo - surtout dans les pianissimo - où la frappe est très précisément mesurée, puis appliquée sans excès.
Puis, finalement, Tharaud attaque enfin Gaspard de la Nuit, le poème pianistique que Ravel a construit autour d’une œuvre d’Aloysius Bertrand [2]. Comme pour Bach la technique est parfaite, le pianiste est parcouru de secousses électriques, même dans les pianissimo - surtout dans les pianissimo - où la frappe est très précisément mesurée, puis appliquée sans excès.
Un minimum d’attention permet alors de suivre pleinement le fil de la musique. On sursaute, frémit, décolle, retombe. Encore une fois, la musique se "compose", non comme une suite de notes plus ou moins liées mais comme un ensemble organique que le piano nous fait traverser, palper, sentir.
Une sorte de paysage lunaire clôt le triptyque, hérissé de projection sonore, couturé d’ambitions folles qui retombent en grondement sourd ou s’effilochent en murmures ciselés.
Pour en savoir plus sur Alexandre Tharaud
Pour connaître sa discographie
par François A.
Article mis en ligne le 19 août 2004 (réédition)
Publication originale 20 août 2004




